Pénurie de soignants : la Suisse au pied du mur, mais des solutions émergent
D’ici 2035, il manquera près d’un demi-million de travailleurs en Suisse. Pas seulement dans l’industrie ou l’éducation. Dans la santé surtout. Selon les projections d’économie suisse, 460’000 équivalents pleins temps feront défaut pour compenser les départs massifs à la retraite des baby-boomers. Or le secteur de la santé se trouve en première ligne de cette vague silencieuse : jamais les besoins en soins n’ont été aussi élevés, et jamais le nombre de professionnels disponibles n’a semblé aussi fragile.
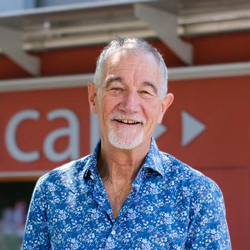
Philippe Schaller
Fondateur, Réseau Delta
Cette « double peine » – hausse de la demande et raréfaction de l’offre – s’annonce comme l’un des plus grands défis sociaux et économiques de la prochaine décennie.
La première ligne, un pilier en danger
La statistique médicale 2024 de la FMH est sans appel : la Suisse comptait 42 602 médecins en activité, soit une progression de 3,7 % en un an. Un chiffre positif en apparence, mais largement insuffisant face aux besoins croissants. Car l’âge moyen des médecins continue d’augmenter : 49,7 ans aujourd’hui, un quart ayant déjà dépassé les 60 ans. La relève existe, mais elle arrive trop lentement pour compenser la vague de départs à la retraite qui s’annonce.
La médecine de premier recours – généralistes, internistes, pédiatres – est la plus exposée. La densité médicale y reste trop faible, avec 0,8 équivalent pleins temps pour 1000 habitants, alors qu’il en faudrait au moins un. Conséquence : des cabinets surchargés, des patients qui peinent à obtenir un rendez-vous, et des urgences hospitalières saturées.
Autre constat préoccupant : plus de 40 % des médecins exerçant en Suisse ont été formés à l’étranger. L’Allemagne fournit à elle seule la moitié de cette main-d’œuvre, suivie par l’Italie, la France et l’Autriche. Une dépendance risquée : si les pays voisins améliorent leurs conditions d’exercice, la Suisse se retrouvera brutalement en pénurie massive.
À cela s’ajoute une transformation silencieuse des pratiques : le taux d’activité baisse. Les jeunes médecins – et surtout les femmes, désormais près de la moitié des diplômés – choisissent davantage le temps partiel et privilégient les cabinets de groupe. Une évolution légitime, mais qui réduit encore la disponibilité globale pour les patients.
Le risque d’un système à bout de souffle
Les effets sont déjà visibles : files d’attente, frustration des patients, charge mentale accrue pour les soignants. Les médecins de premier recours disent avoir atteint la limite de leurs capacités. L’accès aux soins se dégrade, l’équité est mise à mal. Derrière les chiffres se dessine un risque majeur : celui d’un système à deux vitesses, où certains renoncent à se soigner faute de temps ou d’argent.
Le Réseau Delta alerte depuis plusieurs années sur cette problématique du renoncement aux soins pour des raisons financières. De nombreux patients renoncent aujourd’hui à consulter leur médecin traitant ou à suivre un traitement, faute de moyens.
Et ce n’est pas seulement une question d’effectifs. C’est aussi un problème d’organisation. Le modèle actuel, centré presque exclusivement sur le médecin, atteint ses limites. Les pathologies chroniques nécessitent un suivi régulier, pluridisciplinaire et coordonné. Or le système peine à mobiliser pleinement les autres compétences disponibles : infirmières, pharmaciens, physiothérapeutes, diététiciennes, psychologues.
Face à ce constat, l’idée de simplement « former plus de médecins » est une réponse trop courte. Augmenter les places d’études, oui. Mais cela ne suffira pas. La vraie question est ailleurs : comment organiser autrement la santé, pour mieux utiliser les ressources humaines existantes et redonner du souffle aux soignants ?
Maisons de santé et nouveaux métiers
C’est là qu’apparaissent les pistes les plus prometteuses. À Genève, les maisons de santé émergent comme des lieux pivots : des équipes pluridisciplinaires, des ressources mutualisées, une meilleure continuité de soins. En Vaud, la création d’infirmières en pratique avancée (IPA) et de coordinatrices en médecine ambulatoire (CMA) ouvre des perspectives inédites. Ces nouveaux métiers permettent de déléguer certaines tâches, d’assurer le suivi des patients chroniques tout en libérerant du temps médical pour les situations plus complexes.
Les pharmaciens, longtemps cantonnés à la délivrance de médicaments, peuvent ainsi jouer un rôle accru dans la prévention, la vaccination et le suivi thérapeutique. Les physiothérapeutes et les diététiciennes, intégrés dans des programmes structurés de santé, apportent leur expertise pour réduire les complications, améliorer l’autonomie des patients et prévenir des hospitalisations coûteuses.
En d’autres termes : il ne s’agit pas seulement d’avoir « plus de soignants », mais d’avoir des équipes mieux organisées, interconnectées et complémentaires.
Le numérique comme levier
Le numérique n’est pas une baguette magique, mais il peut devenir un levier puissant. La télémédecine, déjà en forte croissance depuis la pandémie, permet d’éviter des déplacements inutiles et d’apporter des réponses rapides pour les problèmes simples. Les plateformes de suivi des maladies chroniques – tension artérielle, diabète, santé mentale – peuvent accompagner les patients au quotidien et alerter les soignants en cas de dérive.
L’intelligence artificielle, si elle est sécurisée et éthiquement encadrée, peut aider à structurer les informations, guider les patients dans leurs démarches et proposer des conseils fiables. Non pas pour remplacer le médecin, mais pour filtrer, orienter, réduire la charge d’actes répétitifs qui épuisent le système.
Comment organiser autrement la santé, pour mieux utiliser les ressources humaines existantes et redonner du souffle aux soignants ?
La domotique, elle, ouvre des horizons dans le maintien à domicile : capteurs intelligents, alertes automatiques, coordination des soins. Elle permet d’accompagner une population vieillissante sans mobiliser à chaque étape un professionnel de santé.
Le pari Delta Santé
C’est précisément cette logique qui inspire le modèle Optimed-Delta Santé, lancé à Genève avec le Groupe Mutuel et le Réseau Delta. L’idée : une approche intégrée où chaque acteur – médecin, infirmière, pharmacien, patient – trouve sa place dans un réseau structuré. Les Points Santé, accessibles gratuitement pour ces assurés, accueillent les urgences mineures sous supervision médicale, réduisant l’afflux aux urgences hospitalières. Les programmes de prévention sont intégrés au suivi des patients. Les outils numériques facilitent ainsi la communication entre professionnels et offrent aux assurés un accès simplifié à leurs données.
Autre mesure forte portée par le Réseau Delta : la suppression de la franchise pour les consultations chez le médecin traitant. Une avancée essentielle pour éviter que des patients renoncent à consulter à cause de contraintes financières.
Ce modèle mise aussi sur la responsabilisation des patients, à travers l’éducation, l’autogestion et l’implication dans les choix de soins. L’objectif : moins de redondances, moins de coûts inutiles, mais surtout plus de temps humain là où il est vraiment nécessaire.
De la crise à l’opportunité
La pénurie de professionnels est une réalité brutale. Mais elle peut aussi être un catalyseur. Elle nous oblige à repenser un système qui, jusqu’ici, a reposé sur l’abondance relative de médecins et d’infirmières. Cette abondance n’existe plus. Il faut inventer autre chose : des organisations collectives, des métiers hybrides, des technologies au service de l’humain.
La Suisse a encore de nombreux atouts : un haut niveau de qualité, des initiatives locales dynamiques, une capacité d’innovation reconnue. Mais le temps presse. Si nous voulons que chaque citoyen ait demain un accès équitable à des soins de qualité, nous devons agir dès aujourd’hui. Et accepter une évidence : la santé de demain ne sera pas une copie de celle d’hier.



Laisser un commentaire